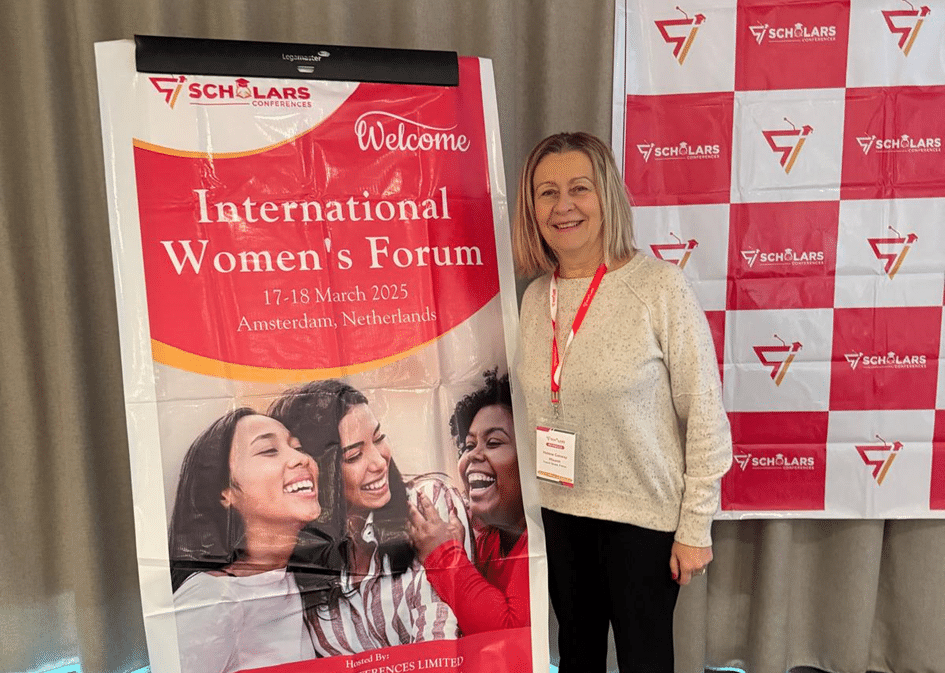J’ai participé à Amsterdam au Women’s Forum durant lequel je suis intervenue sur le thème : « Les femmes comme victimes et actrices des conflits : une double réalité« .
Dans le cadre de mes fonctions de vice-présidente de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, je suis l’évolution et les conséquences des conflits dans le monde. J’ai été frappée de constater que la guerre est encore considérée comme une « affaire d’hommes », les femmes étant souvent invisibilisées. Leur rôle dans les conflits armés est encore peu étudié, alors qu’elles représentent une cible particulièrement vulnérable d’une part, et jouent un rôle de plus en plus actif dans les combats d’autre part.
Le bilan meurtrier des conflits armés consiste souvent à déterminer le nombre de morts sur le champ de bataille, qui sont souvent des hommes. Il élude, bien souvent, les victimes indirectes, qui sont souvent des femmes.
- Les femmes civiles : victimes invisibles mais résilientes
Premièrement, les femmes sont des victimes indirectes des bombardements.
Certes, 88% des victimes directes d’agents explosifs sont des hommes, du fait des normes socio-culturelles : les hommes sont en effet les premiers à pénétrer des zones minées pour déblayer les débris, rechercher des survivants puis reconstruire les habitations.
12% des victimes directes sont des femmes, principalement visées dans les espaces résidentiels et les marchés. Toutefois, celles-ci ont moins de chances d’accéder aux soins et ainsi moins de chances de survie.
L’ONU Femmes a également constaté que les filles et les femmes dont le mari a été tué par un agent explosif ont également plus de risques d’être victimes de mariage forcé, là encore du fait des normes sociales. En effet, dans certaines structures sociales, il est communément admis que le mariage représente une forme de protection de la femme par l’homme.
Deuxièmement, les filles et les femmes sont aussi les principales victimes du recours aux violences sexuelles comme tactiques de guerre.
Selon l’ONU Femmes, bien que ces données soient largement sous-estimées par rapport au nombre réel de victimes :
- Entre 250 000 et 500 000 filles et femmes ont été violées au cours du génocide rwandais en 1994 ;
- Plus de 60 000 durant la guerre civile en Sierra Leone entre 1991 et 2022 ;
- Et entre 20 000 et 50 000 pendant la guerre de Bosnie-Herzégovine entre 1992 et 1995.
- Dans son rapport présenté au Conseil de sécurité le 11 mars 2024, la Représentante spéciale chargée de la question des violences sexuelles en période de conflit Pramila Patten concluait qu’il existait des informations « claires et convaincantes sur des violences sexuelles liées au conflit, notamment des viols et des viols en réunion, commises dans au moins trois sites lors des attentats du 7 octobre 2023 ».
Ces violences fondées sur le genre engendrent un traumatisme psychologique, des blessures physiques, des grossesses non désirées, des maladies sexuellement transmissibles comme le VIH, mais aussi une stigmatisation sociale. Les survivantes peuvent être ostracisées de la vie publique ou s’en éloigner d’elles-mêmes, par crainte ou par honte. L’ONG Oxfam estime qu’au Soudan du Sud, où 65% des filles et des femmes ont subi des violences sexuelles durant le conflit, une adolescente avait trois fois plus de chances de mourir en couche que d’aller à l’école primaire.
Celles-ci augmentent également dans les sociétés à la sortie d’un conflit, en raison de l’effondrement général de l’état de droit, de la dégradation des structures sociales et familiales et de la « normalisation » de ce type de violence qui s’ajoute à la discrimination préexistante.
Troisièmement, les femmes subissent l’effet collatéral du bouleversement des structures sociales et familiales.
Du fait du taux important de décès des hommes et de la destruction des services publics fournis à la population, les femmes sont souvent chargées d’assurer les responsabilités domestiques et familiales.
Cette restructuration des rôles est particulièrement visible en Ukraine. Jusqu’à l’invasion du pays, les femmes occupaient une place centrale dans la vie publique et professionnelle, avec un haut niveau d’éducation et un fort taux d’emploi grâce à des infrastructures sociales qui leur permettaient de faire carrière. Dans la mesure où la majorité des femmes civiles ne sont pas directement sur le terrain dans la guerre avec la Russie, c’est à elles qu’incombe désormais l’injonction sociale de prendre en charge la famille et la scolarisation de leurs enfants quand les écoles sont la cible de bombardements. Nous observons ainsi un retour du rôle traditionnel des femmes au sein du noyau familial et leur exclusion progressive de la vie économique et sociale.
Il incombe aussi aux femmes de chercher d’autres moyens de subsistance, la survie de la famille reposant en grande partie sur elles.
C’est particulièrement le cas lorsque des populations sont déplacées. Dans la bande de Gaza, la destruction de 70% des terres agricoles et la disparition des ressources vivrières engendre une situation d’insécurité alimentaire sévère face à laquelle les femmes, traditionnellement responsables de la gestion du foyer, se retrouvent en première ligne pour subvenir aux besoins de leur famille.
- Les femmes combattantes : de l’exception à la normalité
Une part importante de la littérature scientifique s’intéresse à la situation des femmes en tant que victimes de la violence armée et civile, celles-ci étant perçues comme « extérieures » à l’exercice de la violence militaire. Bien qu’elles soient encore invisibilisées, elles tiennent une place cruciale dans la « sphère combattante ». Il est vrai que les causes qui motivent les femmes à prendre les armes diffèrent en temps de paix, avec une politique d’incitation à l’engagement en faveur de la mixité, et en temps de guerre.
Dans les armées occidentales, et notamment en temps de paix, l’évolution institutionnelle est lente.
Pour prendre l’exemple de l’armée française, la 4ème la plus féminisée au monde derrière les États-Unis, la Hongrie et Israël, seules 6,7% des militaires en opérations extérieures sont des femmes. Ce n’est qu’en 1909 que l’État français a permis aux femmes d’être recrutées dans l’armée française en tant qu’infirmières, sous statut de personnel civil. Il faudra attendre près de 30 ans, avec la loi « Paul Boncour » de 1938, pour que les femmes puissent être mobilisées. La création d’un statut particulier pour le personnel féminin en 1951 ouvre la voie à l’engagement des femmes dans les trois armées. Et pour finir, en 1976, Valérie André, figure que l’on connaît peu en France, devient la première femme générale et la première pilote d’hélicoptère.
Pour la sociologue française Camille Boutron, auteure de l’ouvrage « Combattantes, quand les femmes font la guerre », cette lente évolution s’explique par plusieurs facteurs :
- D’une part, une construction sociale instrumentalise une prétendue différence physiologique entre les femmes et les hommes pour maintenir une hiérarchie des genres. C’est aussi la « division sexuelle du travail », qui associe les fonctions qui ont le plus grand capital symbolique et sont les plus valorisantes aux hommes, et les fonctions les plus routinières aux femmes (les femmes dans cette salle doivent en savoir quelque chose).
- D’autre part, l’ancienne croyance selon laquelle la « nature féminine » centrée sur la maternité et le don de la vie, les rend incompatibles avec l’exercice de la violence.
- Enfin, le milieu social dirige encore les hommes vers des hautes études scientifiques ou d’ingénieurs, qui seront plus naturellement orientés vers les écoles d’officiers.
Nous pouvons ajouter que de nombreux travaux démontrent que la violence militaire, exercée principalement par des hommes, est légitimée au nom de la protection des femmes et des enfants[1].
Mais en réalité, il y a toujours eu, dans tous les conflits, des femmes « combattantes » au sens plus large que celui de soldat, mais aussi de résistantes, insurgées et membres de mouvements paramilitaires. Je pense, parmi tant d’autres, à la Britannique Nancy Wake, journaliste de formation qui a suivi la montée du nazisme. Cette héroïne de la Résistance pendant la Seconde guerre mondiale réussit à soigner et à exfiltrer de nombreux pilotes avant d’être soupçonnée puis arrêtée.
Mais dans les pays en guerre ou en crise, la prise des armes – que ce soit par les hommes et par les femmes – est une question de survie.
L’exemple qui nous vient en tête est celui des femmes combattantes kurdes, au cœur du « mythe guerrier kurde »[2] notamment du fait de leur forte exposition médiatique lors de l’avancée de l’État islamique en Irak et en Syrie en 2014, la bataille de Kobanê en 2015 et la bataille d’Afrin en 2018.
Mais cet engagement féminin est plus ancien : on compte 30% de combattantes dans les rangs du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) dès le début des années 1990 et des unités spécifiquement féminines existent dans la guérilla kurde de Turquie depuis 1995. Elles constituaient environ 40% des effectifs du Parti d’union démocratique (PYD) en 2017. Comme le soulignent Rémy Hémez, chercheur à l’IFRI et Olivier Grojean[3], maître de conférence à l’Université Paris 1, si ces combattantes participent bel et bien à l’efficacité militaire des Kurdes, par leur participation directe aux affrontements, le renforcement global des effectifs mais aussi la peur qu’elles provoqueraient chez combattants de Daesh, les relations entre les femmes et les hommes demeurent très codifiées et ne sauraient s’apparenter à un mouvement féministe ou progressiste. Souvenons-nous des enseignements de la sociologue des médias Rosalind Gill, selon laquelle le traitement médiatique d’un sujet ne peut être considéré comme une retranscription fidèle de la réalité, mais plutôt comme une création symbolique portant un message à destination du public.[4]
Autre exemple avec l’armée israélienne, l’un des huit États au monde à inclure ses citoyennes dans la conscription depuis 1949. Certes, le nombre de femmes au sein de l’institution n’a cessé de croître. Jusqu’au milieu des années 1990, les Forces de défense d’Israël pratiquaient une stricte division du travail selon le genre : au moins 40% d’entre elles étaient affectées à des emplois de bureau et de soutien. L’arrêt « Alice Miller », rendu par la Cour suprême israélienne, a marqué un tournant en enjoignant l’aviation à accepter les femmes dans son école de pilotage. Depuis lors, les postes de combat sont ouverts aux femmes. Néanmoins, « l’armée israélienne, comme la plupart des autres armées, reste une organisation sexuée à l’extrême. Si bien que, malgré leur incorporation systématique, les femmes vivent toujours leur service militaire comme des « étrangères du dedans » ».[5]
Les femmes ukrainiennes, elles, ont vu leur rôle évoluer à partir de la guerre du Donbass. Alors qu’elles occupaient jusqu’alors des fonctions de soutien dans l’armée, elles ont été recrutées en tant que véritables combattantes. Aujourd’hui, environ 40 000 à 60 000 femmes servent dans l’armée, dont 4 000 en première ligne. Au lieu de véhiculer une image mythifiée de la femme combattante ukrainienne, le gouvernement ukrainien cherche plutôt à normaliser la présence féminine dans les forces armées, reflétant une évolution culturelle où la féminisation de l’armée devient un élément central pour renforcer les capacités de défense du pays.
On pourrait enfin se demander si la guerre peut être un lieu d’émancipation des femmes.
La sociologue Camille Boutron montre qu’au sein des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC), la lutte armée a donné naissance au « féminisme insurgent », qui perdure après le conflit pour contrer le rétablissement de l’ordre viril. Les farianas ont continué à se battre pour la visibilité des femmes lors des négociations de paix. Cela illustre comment la lutte armée peut, paradoxalement, favoriser le changement social.
Il est essentiel de comprendre et d’intégrer ces réalités pour mieux répondre aux besoins des femmes dans les zones de conflit, tout en soutenant leur rôle dans la transformation post-conflit. Il est en effet démontré que l’égalité des genres est un facteur déterminant dans le maintien de la paix et que la participation des femmes aux processus de paix allonge la durée et la stabilité des accords.